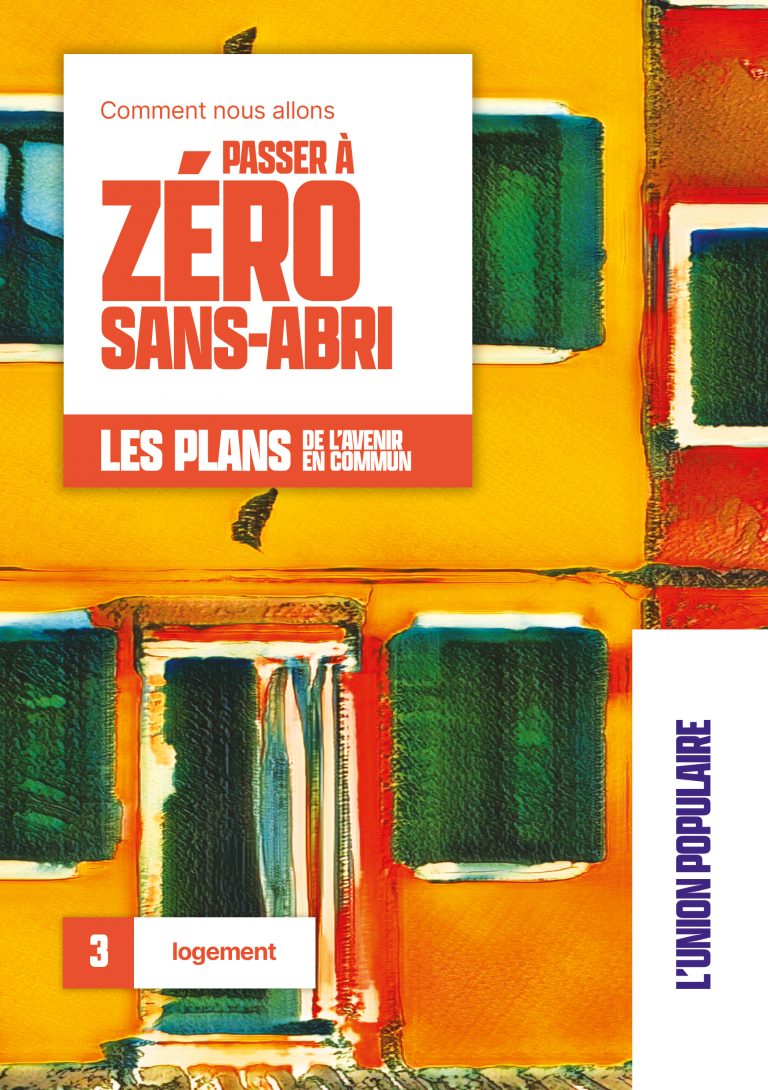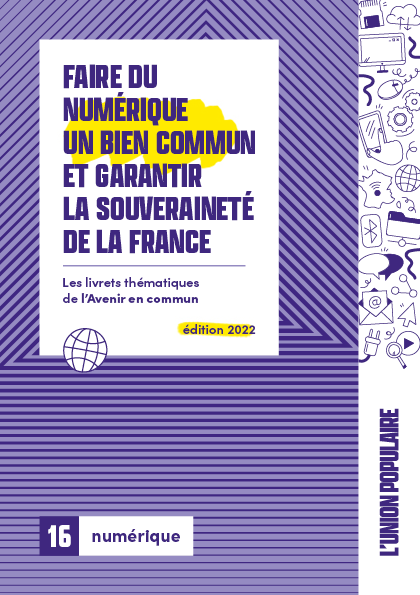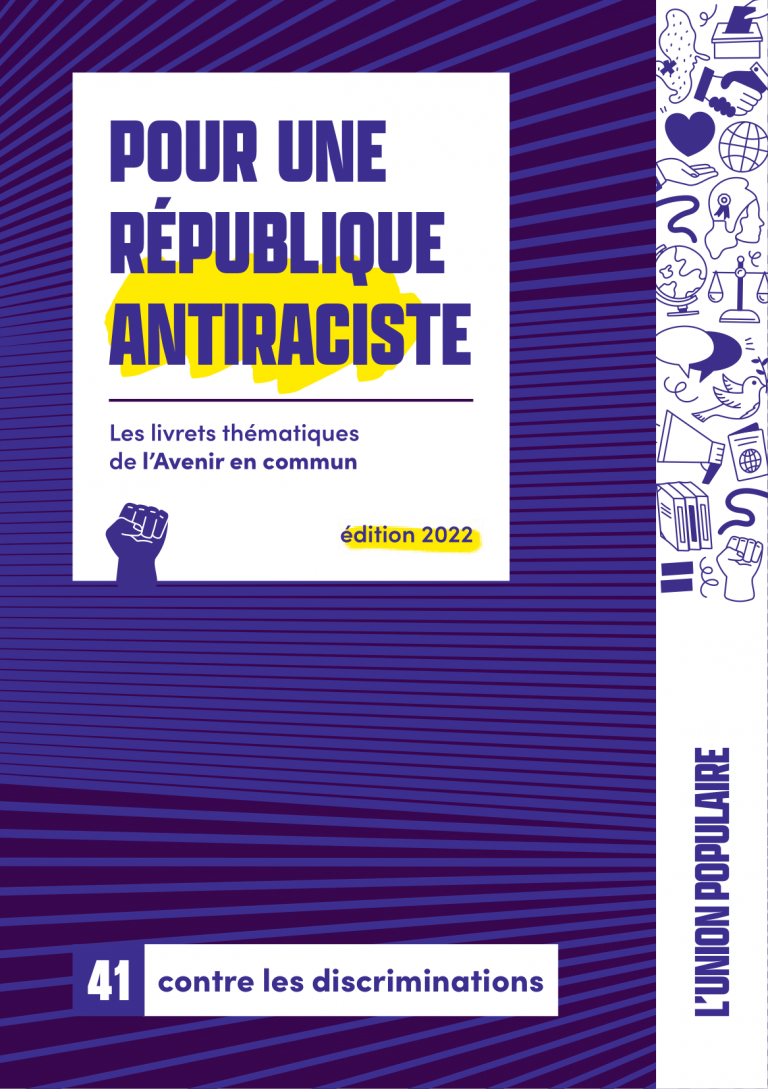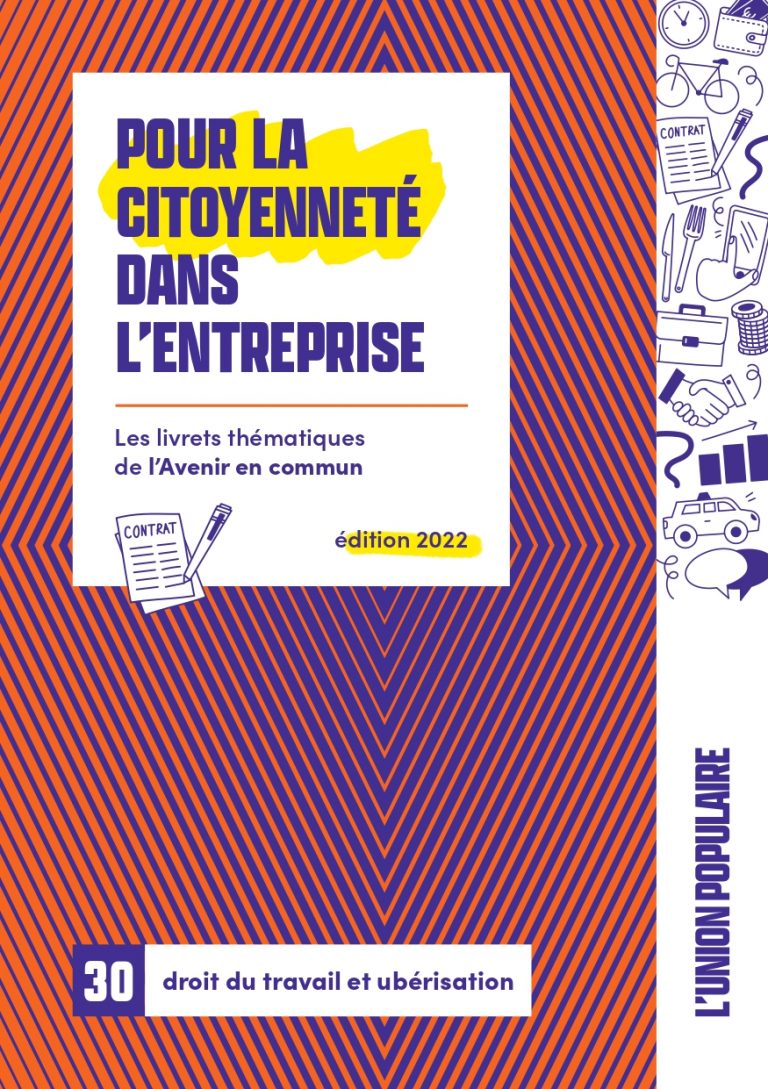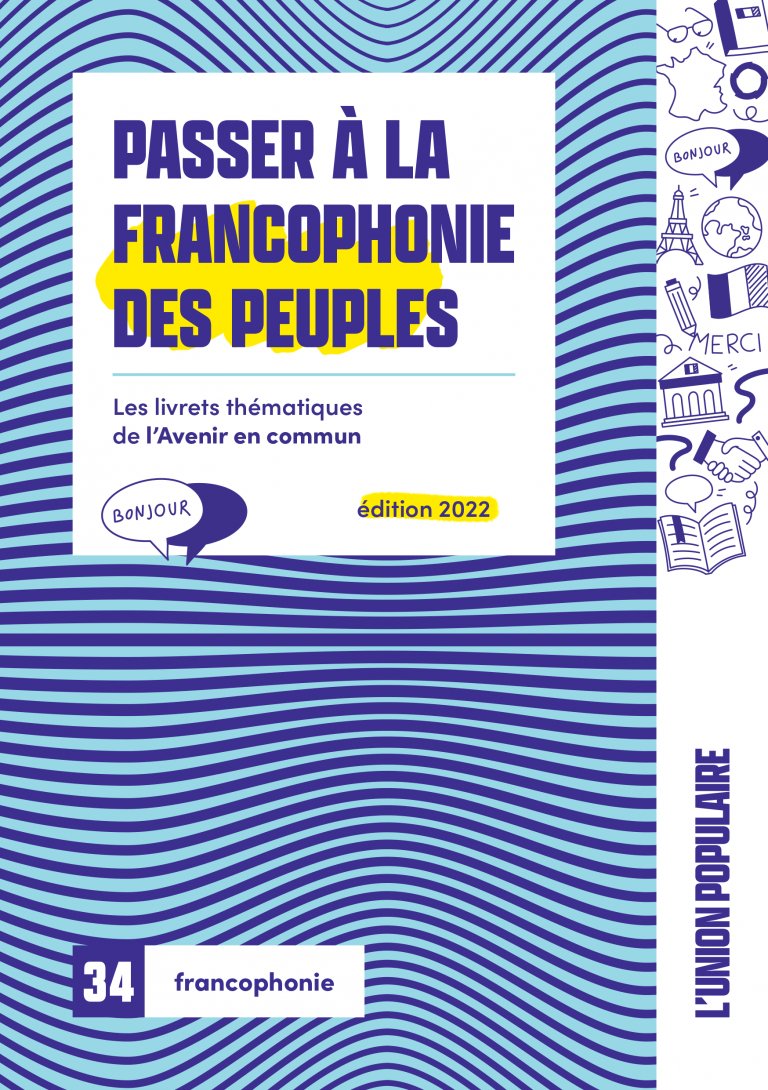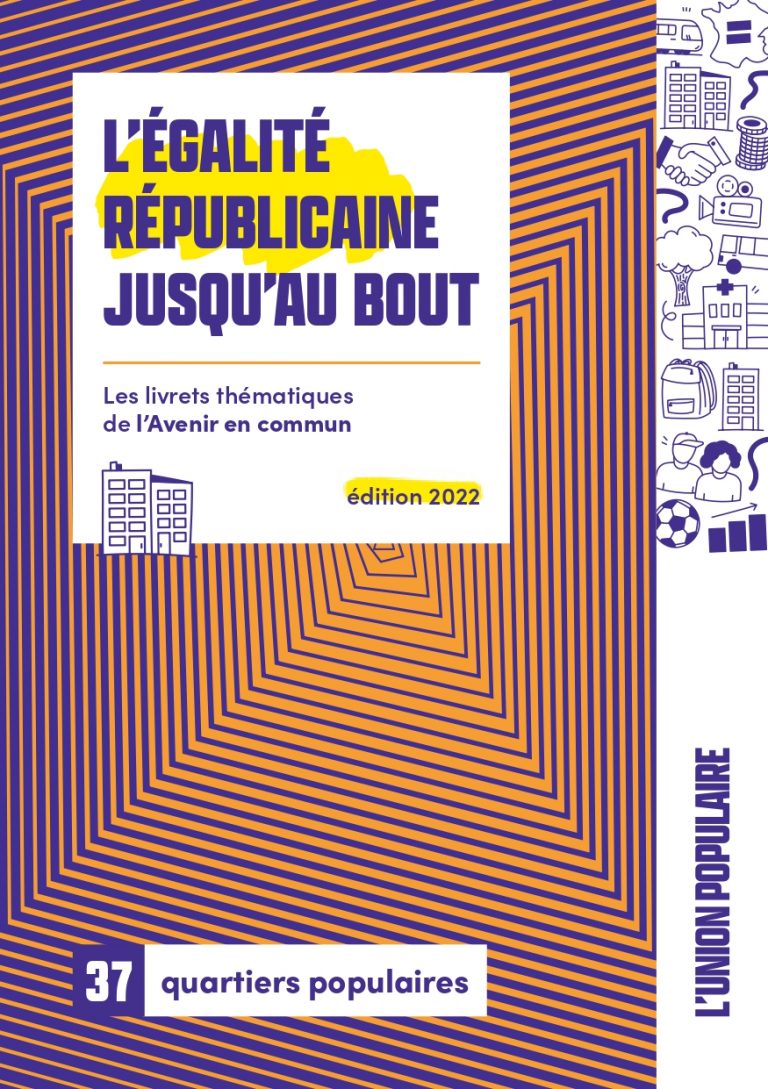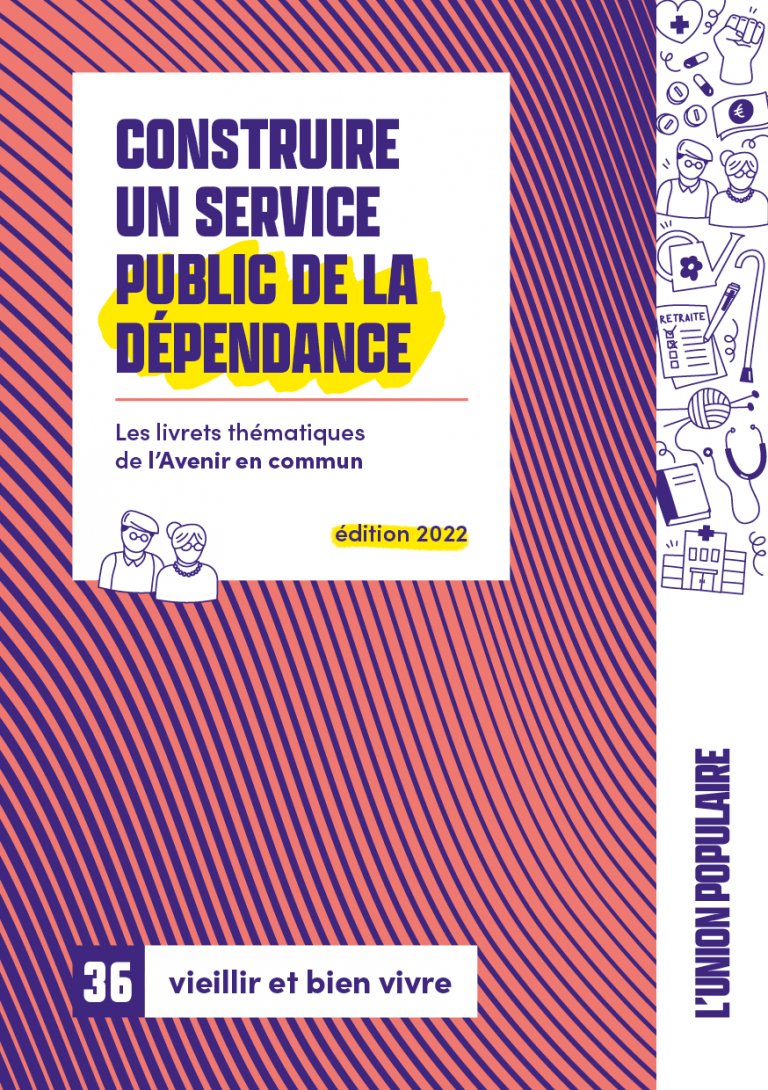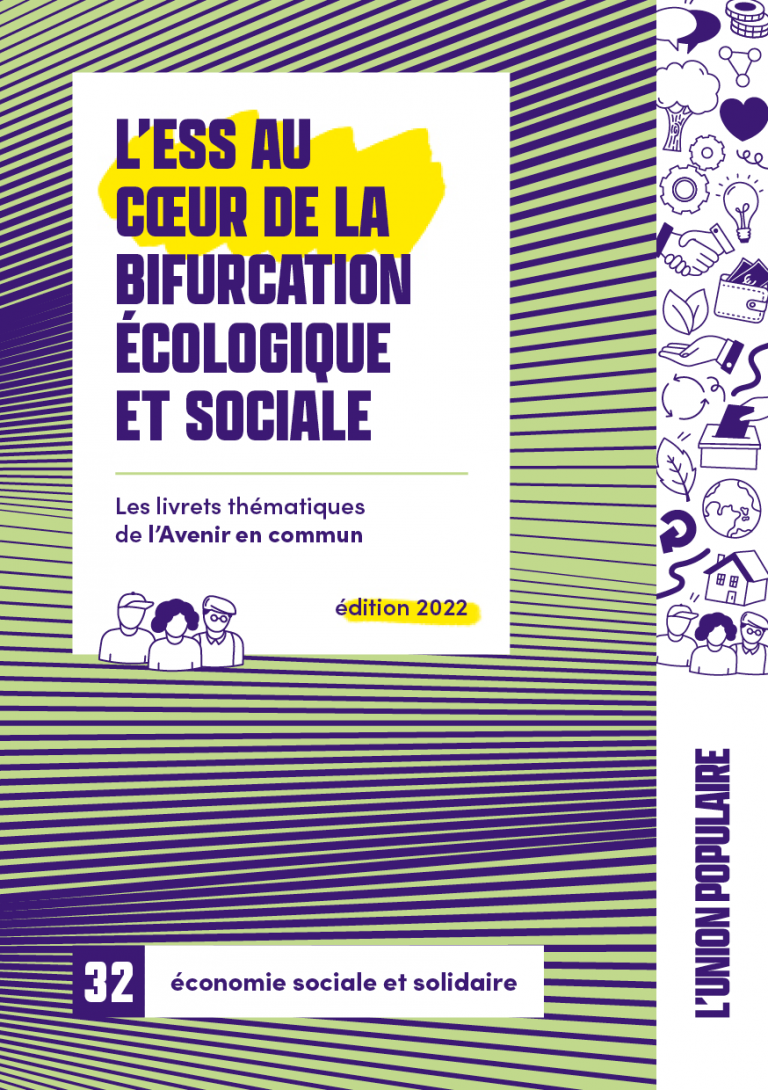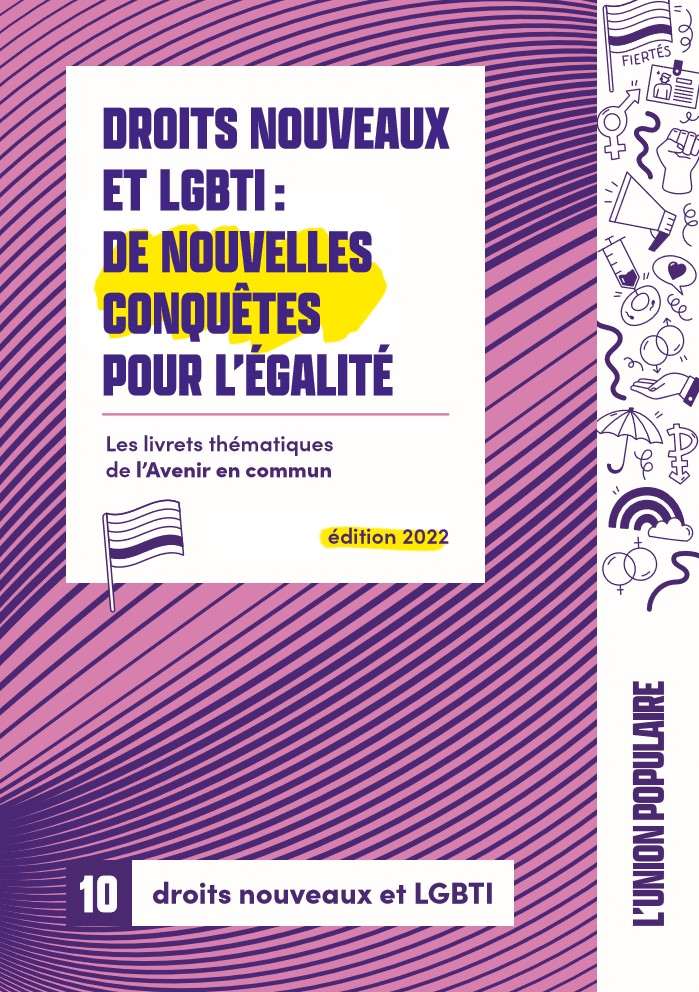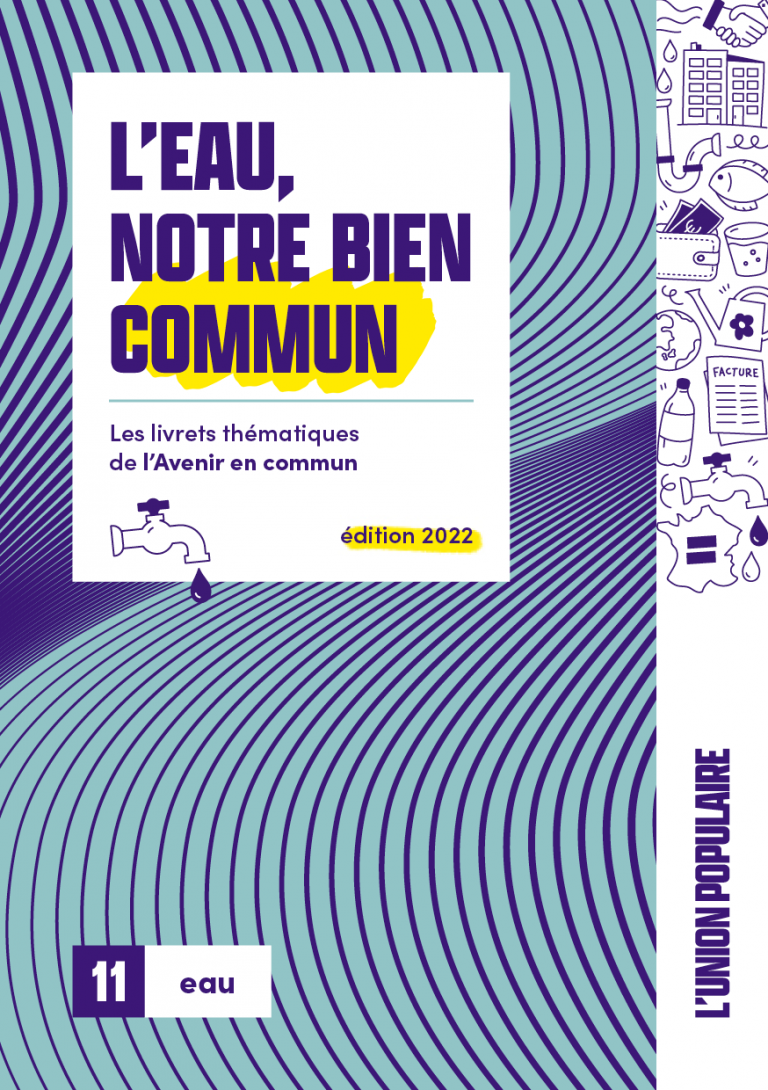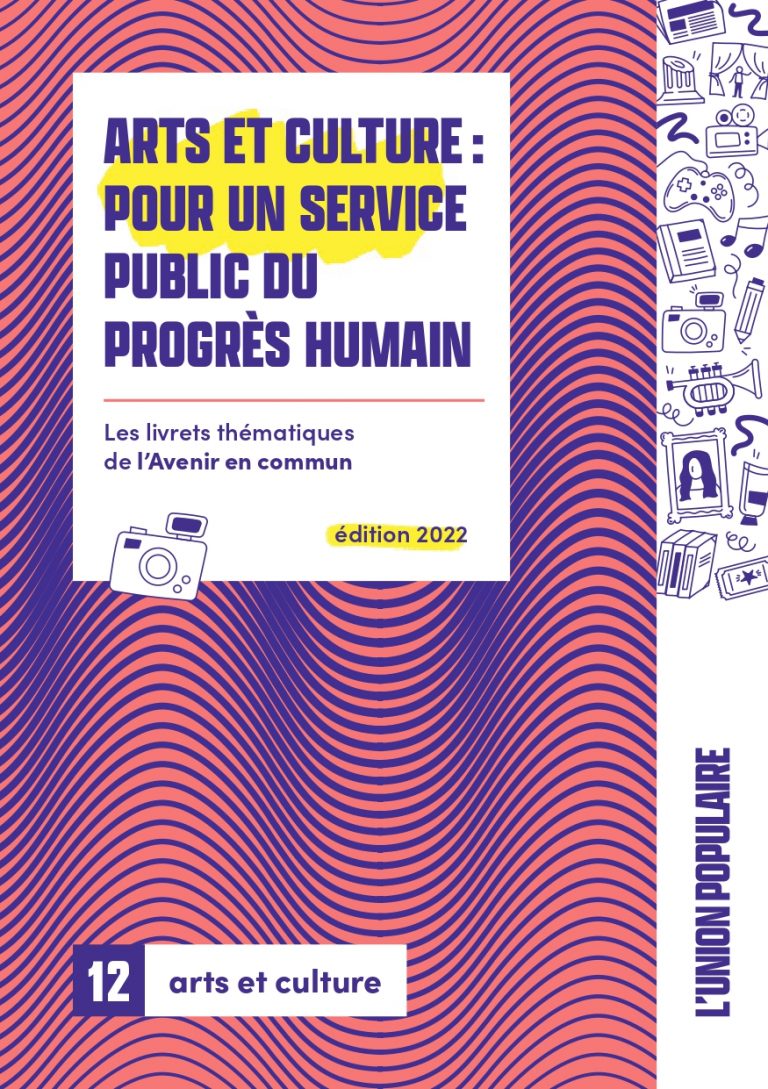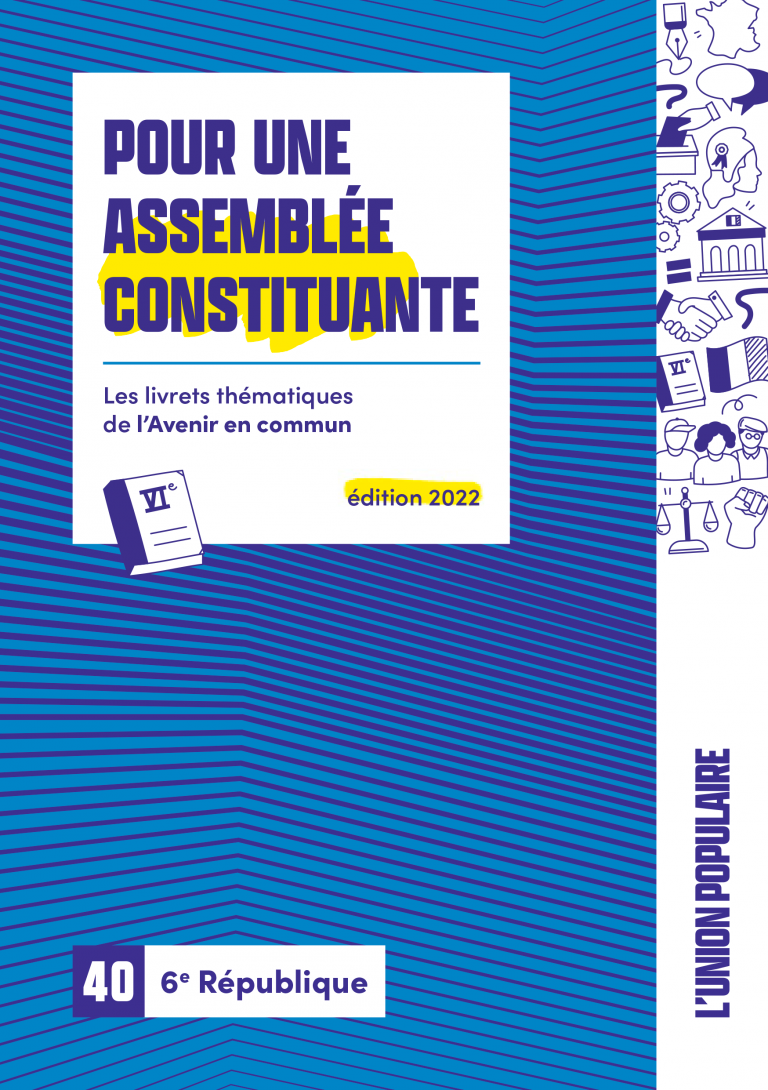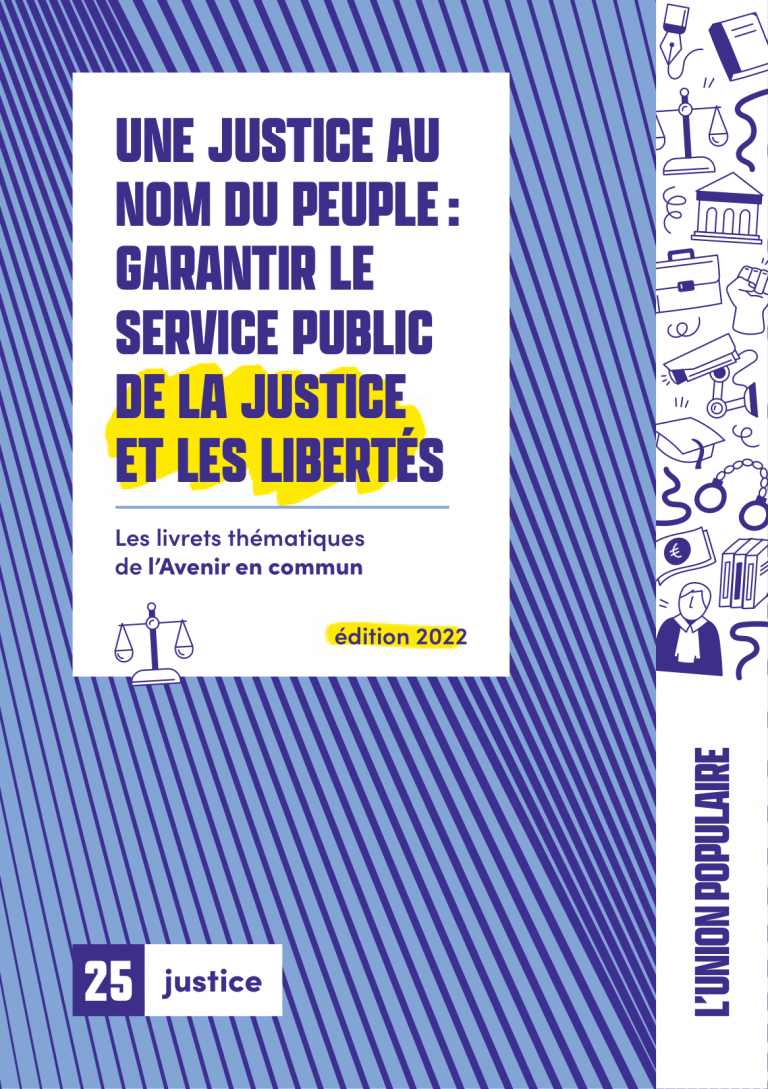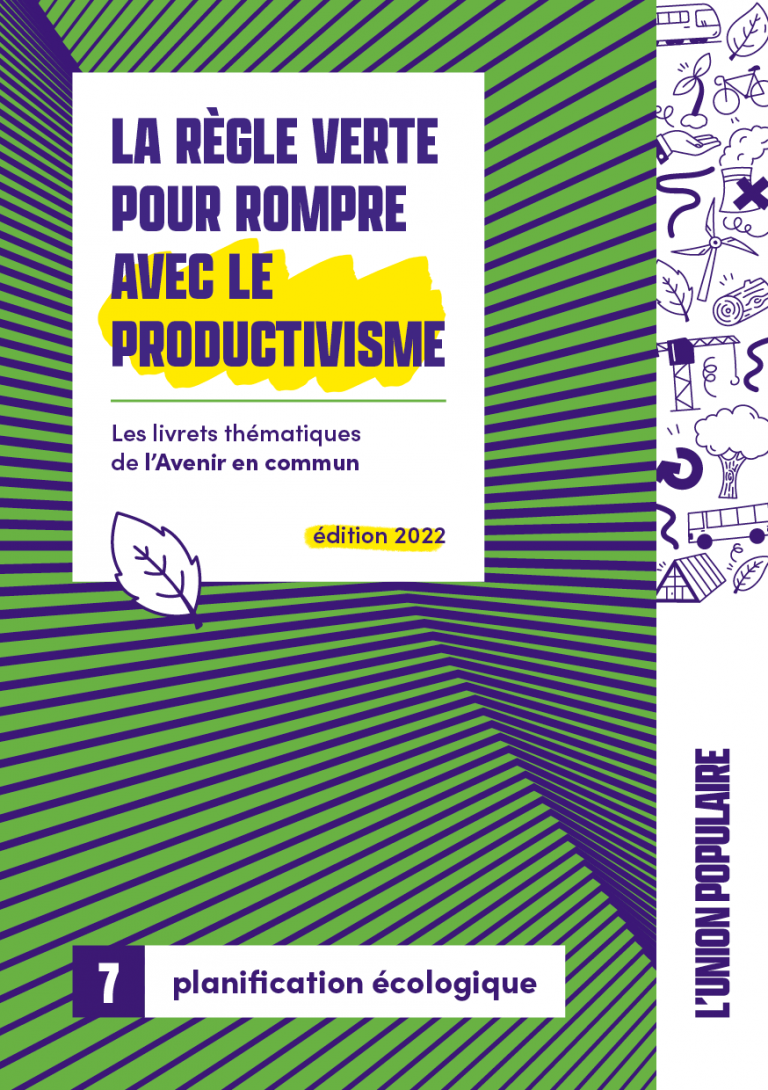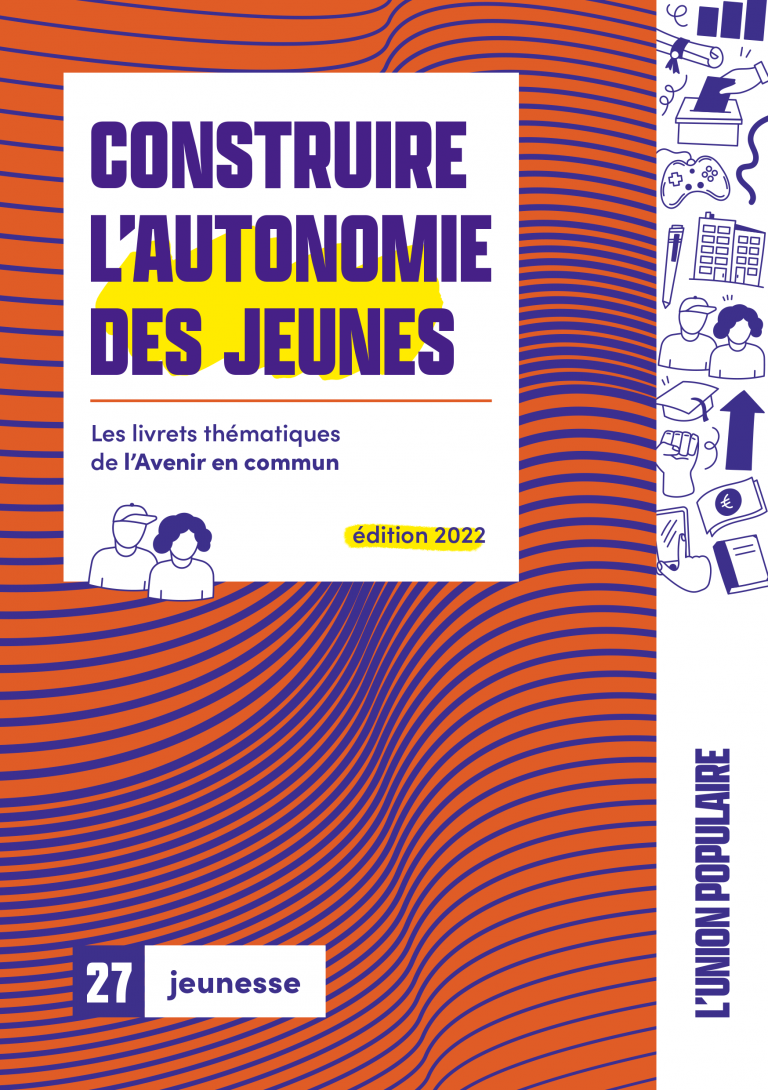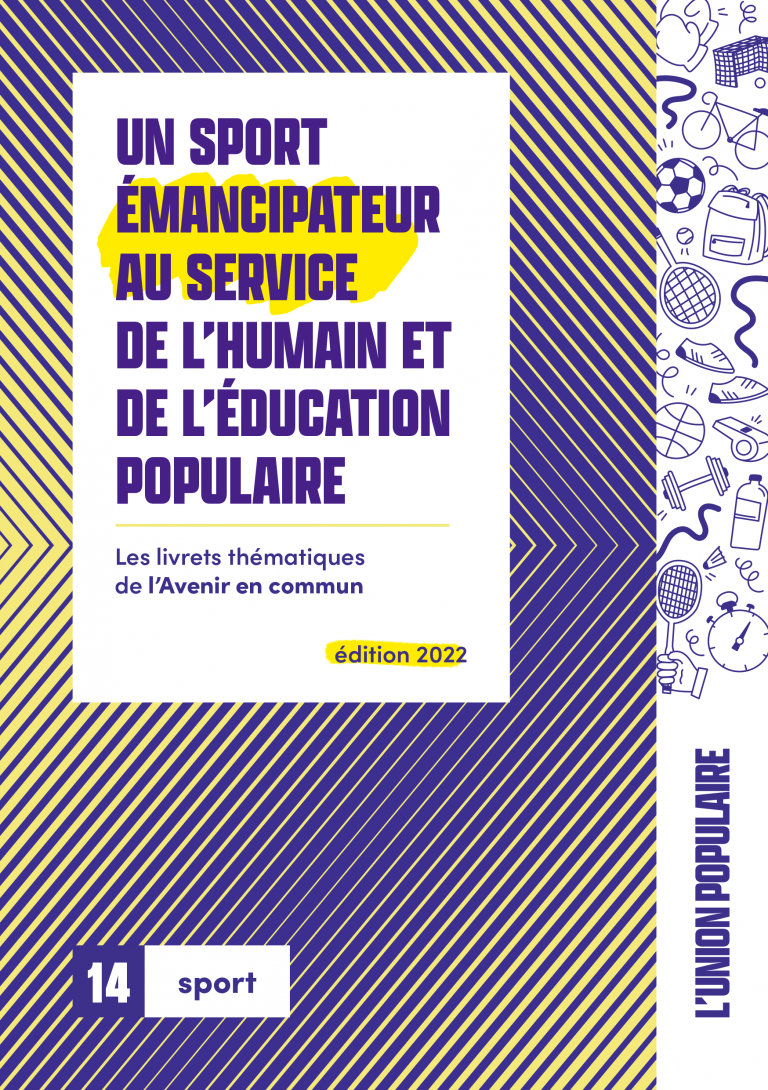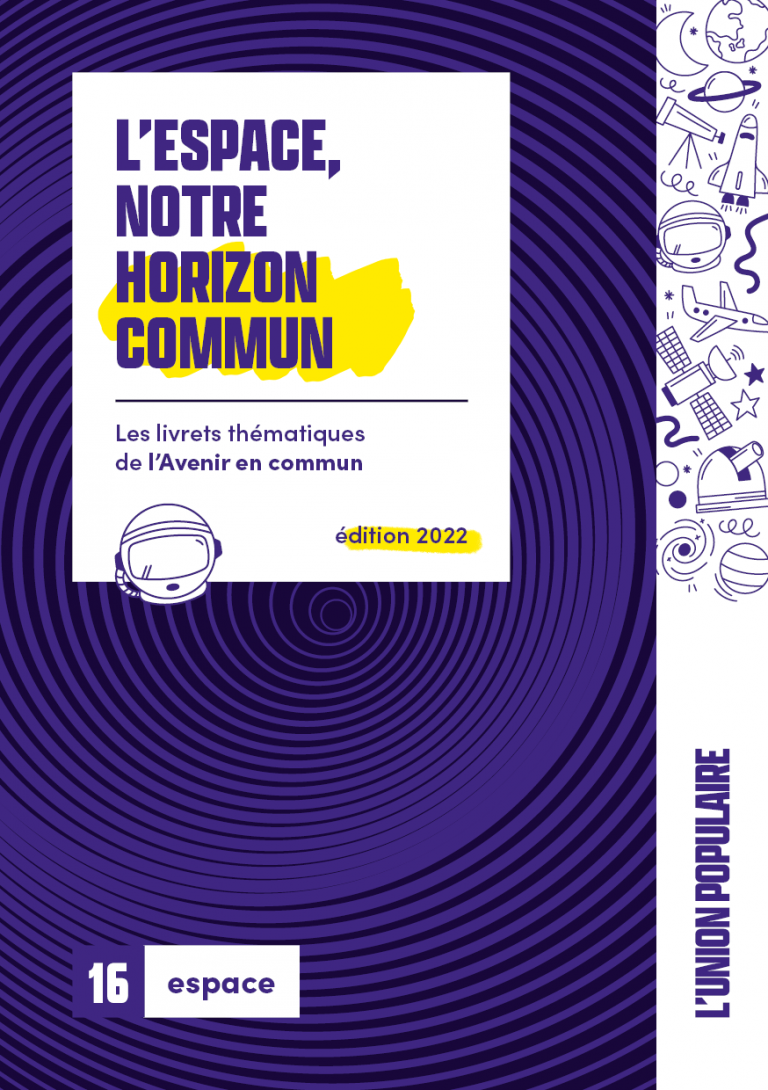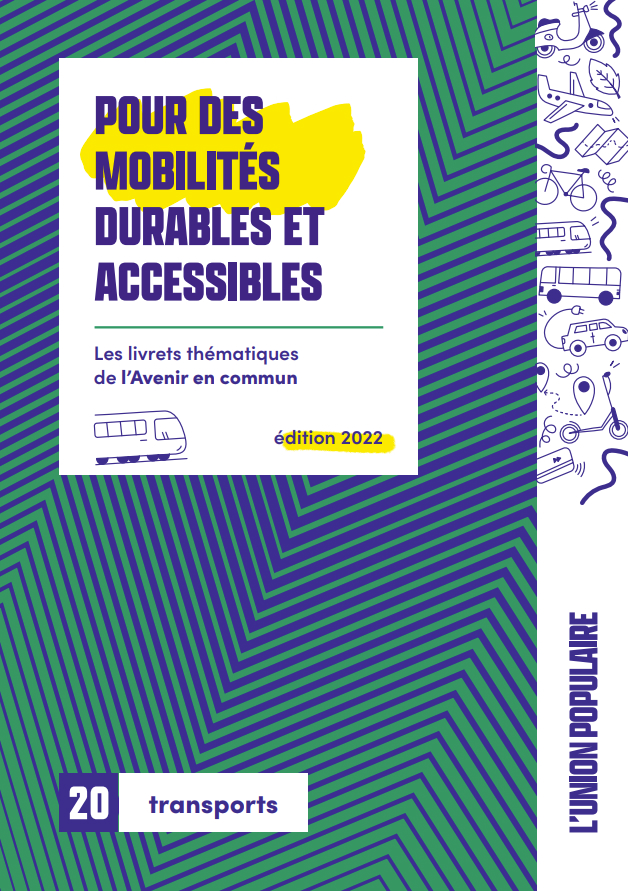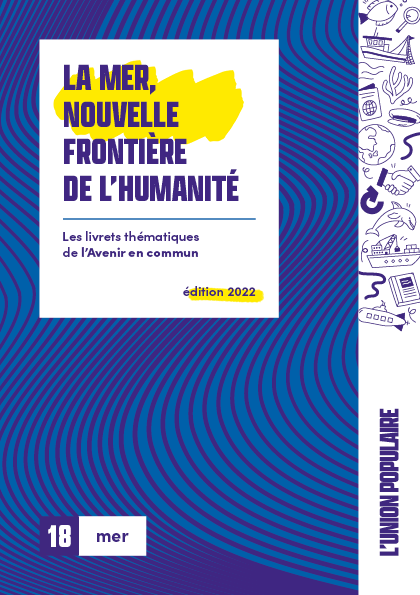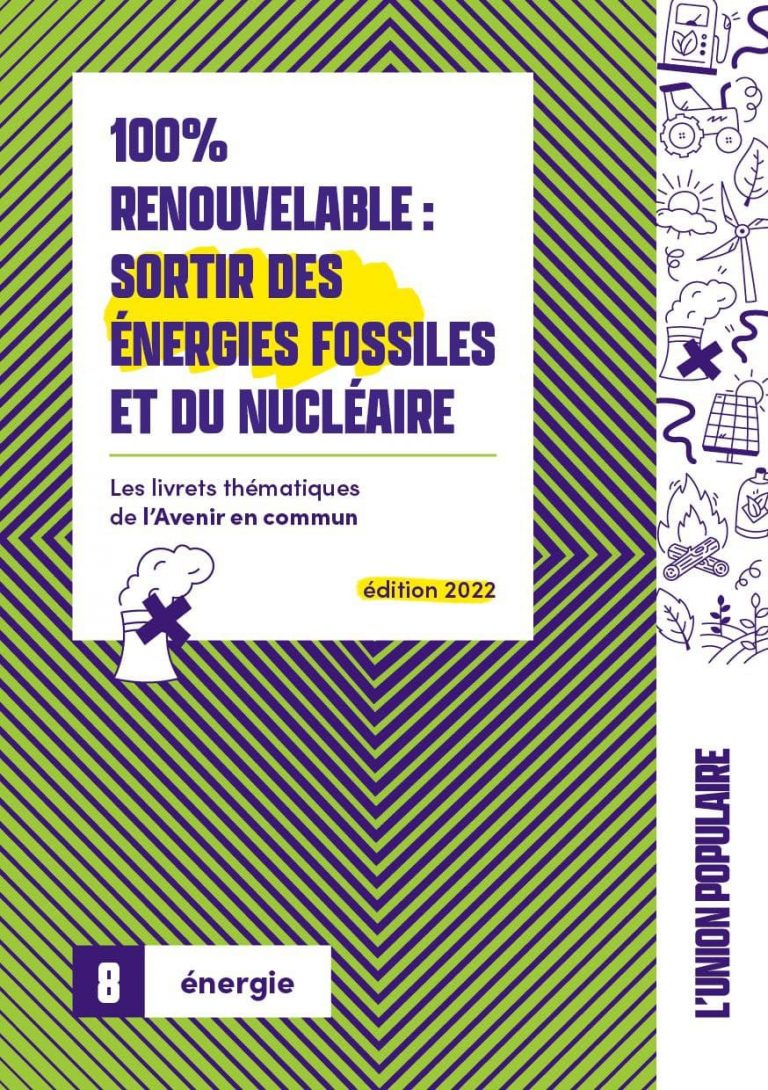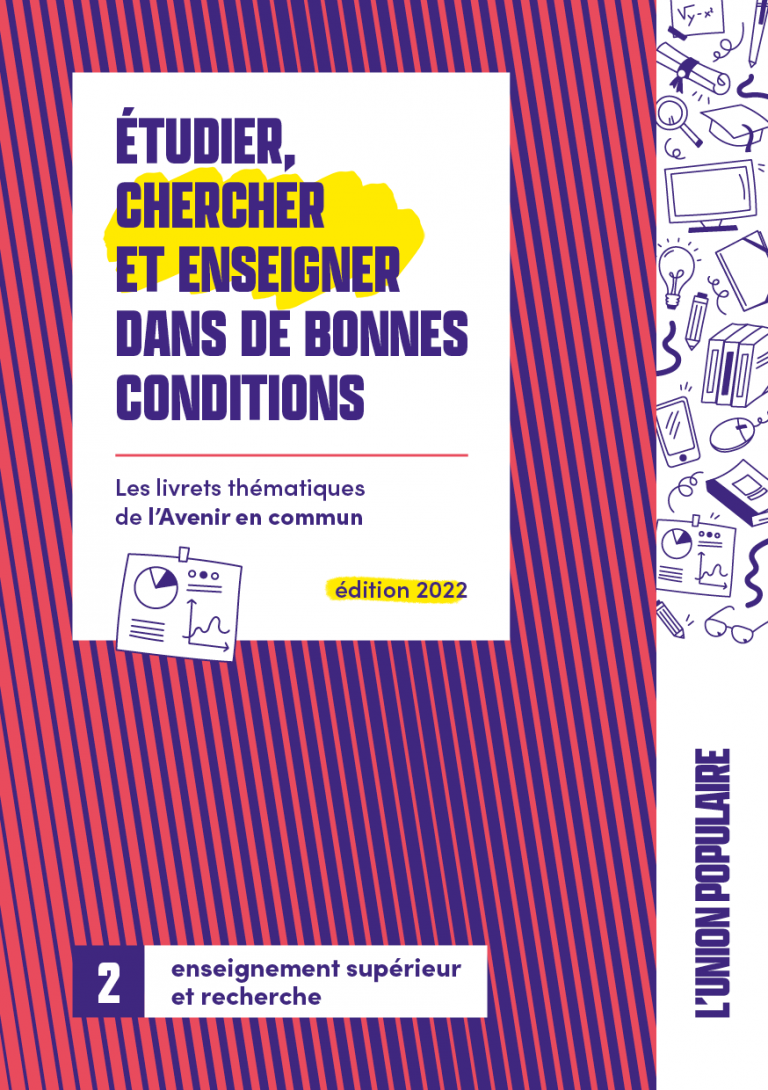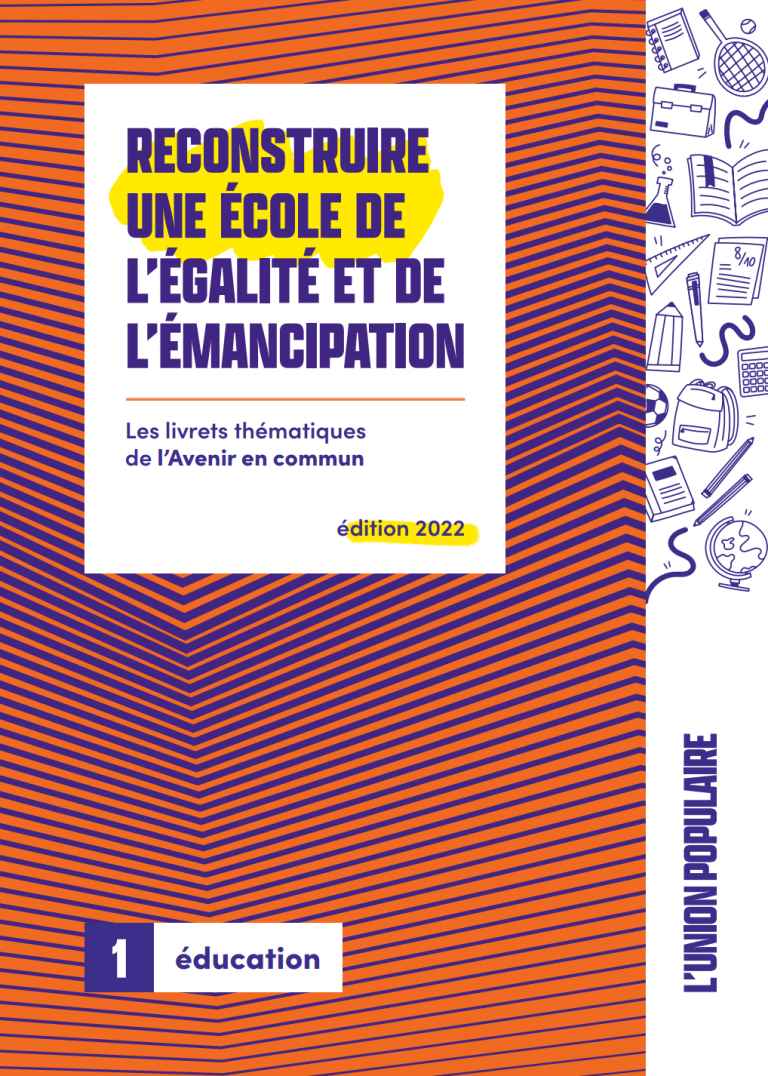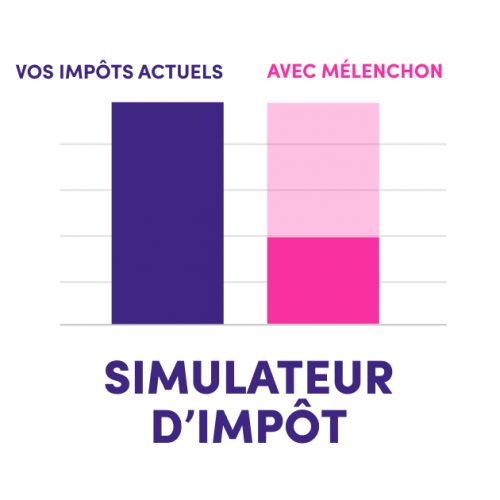Introduction de Jean-Luc Mélenchon
L’éducation est un enjeu central de l’élection présidentielle. Notre futur commun ne sera pas écrit dans le bureau d’un technocrate, mais construit par les jeunes générations. Pourtant, s’il n’est que rarement question d’éducation, il n’est jamais question d’enseignement professionnel.
Pourtant les filières technologiques et professionnelles réunissent la moitié des lycéen·nes de France. Une grande partie de la jeunesse populaire est là. Elle y apprend un métier, des savoirs, y atteint des qualifications professionnelles. Car une économie productive, une industrie, c’est d’abord des ouvrier·es, des technicien·nes, des ingénieur·es qualifié·es, femmes et hommes passionné·es par leur métier.
Mettre côte à côte un tas de matériaux et un tas d’argent n’a jamais créé le moindre avion, la moindre locomotive, la moindre turbine. La richesse réelle n’est créée que par le travail humain.
Les qualifications sont le contenu concret du travail humain. Elles ne s’acquièrent, se transmettent et s’améliorent que par un seul moyen : l’éducation.
Sans enseignement professionnel de qualité, il ne peut y avoir de société développée. C’est pourquoi l’avenir du pays se décide dans ses lycées professionnels. De même, il ne peut y avoir de futur économique et social pour le pays sans une recherche publique puissante et disposant d’amples moyens.
C’est encore plus vrai du fait de l’immense chantier qui s’annonce devant nous : la bifurcation écologique. Elle concerne tous les secteurs, de l’énergie aux transports, du bâtiment à la métallurgie, du bois à l’agriculture. Dans chacun de ces secteurs, il y aura des besoins énormes de travailleur ses qualifié es, et une impérative nécessité d’une progression permanente des savoirs.
La planification écologique nécessite un niveau de qualification très élevé. C’est pourquoi elle s’appuie en grande partie sur le relèvement du lycée professionnel. Ces vingt dernières années, la France a été gouvernée par des forces qui ont méprisé le lycée professionnel.
Pour faire des économies, le diplôme du baccalauréat professionnel a été réduit de quatre à trois années en 2007. Puis, Emmanuel Macron a transformé la première année en année de « découverte » d’une « famille de métiers », ne laissant plus que deux ans pour l’acquisition des savoirs.
Nous rétablirons le baccalauréat professionnel en quatre années pleines. C’est ce qu’il faut pour arriver au haut niveau de qualification dont nous avons besoin. Nous investirons dans l’enseignement professionnel et la recherche publique dans le but de produire la génération la plus qualifiée de l’histoire du pays.
Cela passera notamment par la création sur tout le territoire de centres polytechniques professionnels qui réuniront les formations du CAP au BTS, et assureront pour les salariés la validation des acquis d’expérience (VAE). Et bien sûr, nous donnerons les moyens aux lycéen·nes de l’enseignement professionnel d’apprendre grâce à la garantie d’autonomie de 1 063 euros.
Nous nous opposerons à la création d’un marché des qualifications professionnelles et du savoir. Ce projet a déjà été bien entamé par Macron. Nous le démantèlerons. Il faudra changer le mode de financement de la recherche pour réorienter les cadeaux fiscaux sans contrepartie au privé vers la recherche fondamentale et les instituts de recherche finalisée publics.
Il y a urgence, car le développement et le rayonnement scientifique de la France sont un moteur essentiel de notre indépendance et de l’épanouissement de toutes et tous.
La France est une grande nation du savoir scientifique et technique. Grâce à sa recherche publique et au haut niveau de qualification de ses ouvrier·es, technicien·nes et ingénieur·es, elle a été la protagoniste de découvertes scientifiques essentielles pour l’humanité toute entière : premier micro-ordinateur, hélicoptère, photographie, vaccin contre la rage, moteur à explosion, transfusion sanguine, tablette tactile…
Toute élévation des qualifications est un don à l’humanité entière. La France a des atouts immenses pour construire l’appareil de formation et de recherche dont elle a besoin : des instituts de recherche finalisée de très haut niveau et un système d’enseignement professionnel d’excellence. À condition de réparer les dégâts infligés ces dernières années et de donner à nos systèmes publics d’enseignement et de recherche toute l’ambition, les moyens et la place qu’ils méritent. Ce plan détaille notre méthode pour y parvenir.
Recherche finalisée, transfert : qu’est-ce ?
- Dans la recherche finalisée, les chercheur·ses ou enseignant·es-chercheur·ses partent des problèmes spécifiques posés par un acteur industriel, associatif ou institutionnel pour construire un programme de recherche (par exemple : supprimer les intrants – pesticides, semences, engrais… – dans l’agriculture). Contrairement à la recherche fondamentale, c’est le problème concret, finalisé qui détermine les questions scientifiques fondamentales qui vont être traitées et non l’inverse.
La recherche finalisée est effectuée par des instituts de recherche finalisés (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement [INRAE], Institut national de la santé et de la recherche médicale [INSERM], Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique [Inria]…), mais aussi par des unités impliquant l’université ou le CNRS et dans la recherche et développement des entreprises privées.
- Le transfert est le processus qui désigne le passage à l’industrie ou aux acteurs institutionnels de savoirs ou de technologies résultant de la recherche publique, dans le but de produire de nouveaux produits et/ou services.
Ce transfert peut être réalisé par le biais d’institutions spécifiques – instituts de transfert – qui peuvent ou non être aussi des instituts de gestion. Par exemple, dans l’agriculture, le transfert passe notamment par les instituts techniques agricoles. L’Office national des forêts (ONF) est, quant à lui, à la fois un institut de transfert et de gestion.
Une formation privatisée et un service public de recherche affaibli
Ces cinq dernières années ont parachevé l’entreprise de sabotage des services publics de l’éducation et de la recherche. Jean-Michel Blanquer, déjà à la manœuvre sous Nicolas Sarkozy, et Frédérique Vidal, toute occupée à organiser la police de la pensée à l’université, en ont été les fossoyeurs.
L’école et la recherche ont été saccagées par nos dirigeants – François Hollande inclus –, qui ont épousé la vision néolibérale promue par l’Union européenne : faire du savoir une marchandise, organiser la compétition entre établissements et abandonner la formation et l’enseignement professionnels aux entreprises.
Il faut dire que l’enjeu est de taille : les dépenses annuelles d’éducation représentent plus de 160 milliards d’euros, soit près de 7 % du produit intérieur brut (PIB). De quoi aiguiser l’appétit des entreprises privées.
L’enseignement professionnel a été sabordé
Loin d’être aveugles, les coupes budgétaires massives qu’a connues l’Éducation nationale ont frappé en priorité la voie professionnelle. Trente-sept ans après la création du bac professionnel, l’enseignement professionnel public est en voie de destruction.
Les trois derniers quinquennats se sont acharnés sur l’enseignement professionnel dans un cocktail dévastateur fait de mépris pour les qualifications et de logique comptable bornée. Parce qu’il comporte, par nécessité pédagogique, un nombre beaucoup moins élevé de lycéen·nes par classe que l’enseignement général, c’est à lui qu’on a fait supporter l’essentiel des suppressions de moyens.
Déjà sous Nicolas Sarkozy, l’enseignement professionnel était concerné par les deux tiers des suppressions de postes du second degré, alors qu’il ne représentait qu’un tiers des lycéen·nes. Un acharnement poursuivi sous François Hollande : les belles promesses d’ouverture de postes et de revalorisation des salaires sont restées lettre morte.
Ainsi, en 2020, l’enseignement professionnel accueillait 60 000 lycéen·nes en moins par rapport à 2010, tandis que, sur la même période, l’ensemble du second degré recevait 333 000 élèves supplémentaires !
L’enseignement professionnel est uniquement pensé selon des critères comptables. Le passage de la durée de préparation du baccalauréat professionnel de quatre ans à trois ans en est un exemple frappant. C’est un choix aberrant sur le plan pédagogique et éducatif. Le résultat est prévisible : l’échec augmente et plus de 100 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification. Depuis, Jean-Michel Blanquer a encore aggravé la situation en transformant la seconde en année de découverte d’une « famille de métiers », limitant l’enseignement professionnel proprement dit à deux années avant le baccalauréat.
Le cadre national de la formation a été démantelé bout par bout. Avec la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, chaque collège détermine une partie de ses enseignements. Avec la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer, ce sont les lycées qui définissent chacun leurs spécialités. Avec la loi Pénicaud, ce sont chaque branche professionnelle et chaque entreprise qui ont la main sur la formation professionnelle et agricole. À tous les niveaux, la concurrence s’installe : chacun fait ce qu’il veut ou peut, les uns contre les autres.
L’impasse du tout-apprentissage
Le « tout apprentissage », tant vanté par les quinquennats Sarkozy-Hollande-Macron, est une impasse. Les jeunes qui choisissent l’apprentissage ont beaucoup moins de chances d’obtenir leur diplôme que les jeunes qui choisissent de se former en lycée professionnel. La réalité derrière cette politique est surtout celle de milliards d’euros de subventions publiques versées aux entreprises pour l’embauche d’apprenti·es plutôt que dans les lycées professionnels et agricoles : 137 lycées professionnels autonomes ont fermé depuis 2010 et l’artisanat, première entreprise de France, fait face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Les centres de formation d’apprentis (CFA) ont été livrés au marché avec la suppression de l’autorisation préalable à l’ouverture. La réforme du financement de l’apprentissage a fait porter l’essentiel de leur financement sur les choix privés. Résultat : les formations les moins « rentables » ferment, tandis que les CFA d’entreprises, eux, se multiplient. Ainsi, le marché met la main sur la formation.
À court terme, entreprises et jeunes pensent y trouver leur compte : les premières en formant des travailleuses et des travailleurs directement employables, modelé·es selon leurs besoins du moment ; les seconds dans l’espoir d’être embauchés dans l’entreprise qui les forme.
Dans la durée, tout le monde est perdant. L’école intégrée à l’entreprise est en effet incapable d’armer les jeunes gens concernés des savoirs et savoir-faire généraux. Ce sont pourtant ceux-là qui créent des qualifications durables, qui seules permettent aux travailleurs et aux travailleuses de s’approprier véritablement leur travail et de ne pas être seulement des exécutant·es assigné·es à des tâches rudimentaires.
La qualification des travailleur·ses doit être plus vaste que celle des postes qu’ils et elles occupent, pour leur permettre de s’adapter aux sauts technologiques de plus en plus rapprochés et aux bouleversements des process de production. C’est en ce sens que nous utilisons le terme de « qualifications » et non uniquement de « compétences », qui sont, elles, limitées dans le temps et non nécessairement transposables.
Les jeunes ainsi formés sont perdants. Attachés à leur poste de travail, ils sont plus vulnérables que jamais en cas d’évolution de l’outil de production, de délocalisation ou de faillite de leur entreprise, car ils sont dotés uniquement d’une « employabilité » locale dont la validité est limitée dans le temps : en témoignent la durée désormais limitée de validité des certifications.
Les entreprises sont également perdantes : la pénurie de travailleur·ses qualifié·es, et donc la difficulté à recruter, est en effet au bout du chemin. Les économies qu’elles croient avoir réalisées en évitant le temps d’adaptation d’un nouveau salarié au poste de travail et en bénéficiant pendant ce temps d’une main-d’œuvre sous-payée ne sont en réalité rien par rapport à ce qu’elles y perdent en capacité d’adaptation et d’évolution.
Un système de formation continue marchandisé
La formation continue des salarié·es, soumise à la pression constante des entreprises, a peu à peu été dépecée.
Là où la formation continue devrait jouer un rôle de rattrapage pour celles et ceux qu’un système éducatif rendu inégalitaire n’a pas pu qualifier, la réalité est toute autre. Elle s’adresse d’abord aux plus diplômé·es et laisse sur le bas-côté les moins qualifié·es.
Avec ses trente milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, la formation continue est un objet de convoitise pour le marché depuis sa mise en place en 1971. Depuis vingt ans et singulièrement sous le mandat d’Emmanuel Macron, le marché a gagné bien du terrain. C’est le résultat la marginalisation de la formation professionnelle initiale sous statut scolaire encouragée par les réformes de l’apprentissage, des réductions budgétaires massives subies par les organismes publics de formation des adultes (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes [AFPA], Centre national des arts et métiers [CNAM], groupements d’établissements [GRETA], universités), de la suppression de fait du service public national d’orientation.
Le secteur privé se livre à une concurrence féroce pour s’accaparer les sommes placées sur les comptes personnels de formation (CPF) des salarié·es et des chômeur·ses, rendues mobilisables par un simple clic sur smartphone, comme si on achetait de la formation comme on achète un séjour à l’hôtel, ou un téléviseur. Un marché juteux comme chacun·e peut en juger au nombre d’appels téléphoniques concernant le CPF…
Dans le même temps, un certain patronat, obsédé par la minimisation du « coût du travail », n’a cessé d’exiger la baisse de leurs obligations légales de financement de la formation. Une revendication historique finalement accordée par François Hollande en 2014. Avec à la clé une pression accrue sur les salarié·es pour financer eux-mêmes leurs formations – 1,5 milliard d’euros sont déjà pris en charge directement par eux – et pour se former hors du temps de travail.
La formation continue victime du court-termisme
Autre tendance lourde : les formations sont de plus en plus courtes, de moins en moins valorisées par les salaires et la promotion. Ainsi, la formation continue ne joue pas le rôle qui devrait être le sien dans l’anticipation des mutations et la reconversion : elle est de plus en plus cantonnée aux besoins immédiats (formation à un nouveau logiciel…) ou aux formations obligatoires (sécurité).
Les qualifications, liées aux grilles de classification et codifiées dans les conventions collectives, sont remplacées par des « compétences » individuelles aux contours flous et non reconnus, jugées par des organismes privés contre rémunération.
La marchandisation, le court-termisme et l’individualisation détournent le système de formation de l’objectif d’élévation du niveau global de qualification. Aucune réflexion n’est réellement menée sur l’évolution des besoins à moyens termes en qualification de la main-d’œuvre, ni par l’État, ni par les employeurs.
Cette absence d’anticipation se traduit donc inévitablement par un déficit de main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux évolutions technologiques actuelles, aux besoins de réindustrialisation de l’économie et à l’indispensable bifurcation écologique.
Le service public de recherche affaibli
Dans la recherche, le bilan n’est guère meilleur.
L’ensemble des activités de recherche et développement en France, public et privé confondus, représentaient seulement 2,2 % du PIB en 2019, contre 3 % en Allemagne et aux États-Unis et 2,5 % en moyenne dans l’OCDE.
Le crédit impôt recherche est un échec : détourné par les effets d’aubaine, il profite surtout à des cabinets d’affaires qui montent les dossiers et est encaissé par des grands groupes qui suppriment les emplois de chercheur·ses, comme Sanofi.
Le recrutement des chercheur·ses et enseignant·es-chercheur·ses est en baisse drastique et leurs salaires sont de moins en moins attractifs. Faute de recrutements, la précarité explose et les jeunes chercheur·ses abandonnent de plus en plus la recherche scientifique. Aujourd’hui, un·e chercheur·se au CNRS commence à 1 700 euros par mois environ, après au moins dix ans d’études supérieures et de contrats précaires.
Par manque de crédits pérennes, la recherche s’oriente toujours plus vers des projets pluriannuels sur appels d’offre, avec des procédures bureaucratiques. Un système inefficace et coûteux : près de la moitié du temps consacré à un projet de recherche aujourd’hui est occupé à quémander des financements, à monter des dossiers, à remplir des évaluations incessantes et inadaptées. Le quasi abandon de la recherche fondamentale sur les coronavirus à cause du manque de crédits, après la fin de l’épidémie de SRAS en 2004, est emblématique de cette politique de courte vue.
La recherche fondamentale est délaissée au profit de la recherche d’application pratique immédiate. C’est absurde : l’électricité n’a pas été découverte en améliorant la bougie. Nombre d’innovations découlent de la recherche fondamentale : les travaux d’Albert Einstein ne visaient pas à répondre à un problème immédiat, mais leurs résultats ont permis les théories de la relativité sans lesquelles aucun système de localisation GPS ne fonctionnerait. Le kevlar, les fours à micro-ondes ou encore le velcro sont le fruit d’expériences au hasard.
Par ailleurs, notre société si malade a plus que jamais besoin des sciences humaines et sociales, qui permettent de comprendre les conditions dans lesquelles l’innovation progresse et les qualifications s’élèvent.
L’État ne joue plus son rôle d’impulsion. Il y a des lacunes insupportables. Exemple : nous avons 56 réacteurs nucléaires. Combien de chercheuses et de chercheurs travaillent sur la baisse de la radioactivité des déchets ? Quasiment aucun. Face aux enjeux de notre temps, la France devrait s’être dotée d’une recherche de pointe sur ces enjeux. Mais les gouvernements successifs ont préféré les effets d’annonces court-termistes et laisser s’en aller nos savoirs et nos savoir-faire.
Pire : sur certains secteurs clés de la bifurcation écologique, la France disposait d’importants instituts de recherche finalisée. Ces instituts ont été affaiblis par l’austérité. Mais de surcroît, ils ont été directement entravés par les volontés de réorganisation de l’espace de la recherche. Certains ont tout simplement disparu dans des fusions avec d’autres structures et ils ont tous perdu une grande partie de leurs prérogatives avec la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR).
Plus en aval, de nombreux instituts de transfert ou de gestion ont aussi été très affaiblis. Concernant les forêts, par exemple, la France possédait un service public de qualité pour gérer le domaine public sur tout le territoire. Mais l’Office national des forêts (ONF) a vu ses missions de service public sacrifiées au profit de logiques de rentabilité qui lui ont fait perdre 5 000 emplois sur les 13 000 qu’elle comptait en 2000.
Tout ce processus a affaibli durablement la capacité de l’État à répondre aux enjeux de formation et de recherche. Ce bilan est d’autant plus dramatique dans le contexte de la crise écologique. Pour assurer la transformation radicale de nos modes de production, nous devons rapidement produire des connaissances finalisées et surtout former massivement des salarié·es dans de nombreux secteurs.
Notre stratégie
La bifurcation écologique nécessite de mobiliser des connaissances scientifiques et techniques, et de former les salarié·es dans de nombreux domaines. Face au changement climatique, cet objectif doit se traduire dans la recherche et la formation, en transformant en profondeur l’enseignement professionnel initial et continu.
La révolution agricole vers une agriculture écologique et paysanne, débarrassée des pesticides et herbicides et moins émettrice en gaz à effet de serre, nécessitera de développer nos connaissances et de former massivement en agronomie, en écologie, en biologie fondamentale. Au 21e siècle, le métier de paysan·ne sera un métier au contenu scientifique et technique très élevé.
La bifurcation de notre modèle énergétique requiert quant à elle de nouveaux savoirs et qualifications sur la production et le transport d’énergie, pour tirer parti de tout le potentiel énergétique du pays, notamment maritime. Pour passer au 100 % d’énergies renouvelables, il nous faudra des milliers de métallurgistes, chaudronnier·es, soudeur·ses, électrotechnicien·nes, ouvrier·es de maintenance. Il faudra aussi former massivement à l’éco-construction et à la rénovation thermique pour réduire notre consommation. Nul ne sera laissé sur le bord du chemin : les savoir-faire des travailleurs et travailleuses du nucléaire seront essentiels à la planification du démantèlement des centrales.
Enfin, le changement de modèle de production et de consommation interroge fondamentalement la société : dans ce moment, nous avons besoin des sciences sociales et humaines, de l’économie, de la sociologie, de l’anthropologie.
Former les jeunes gens, les travailleuses et travailleurs d’aujourd’hui ou celles et ceux qui sont privé·es d’emploi est un enjeu qui concerne toute la société. Ce n’est pas le problème d’individus isolés qui choisiraient leur voie professionnelle comme un paquet de céréales.
Nous proposons de faire cesser la logique du « catalogue » de formations, où chaque organisme privé vend sa certification valable pour une durée limitée, dans une région donnée ou pour une seule entreprise.
La production des savoirs et des qualifications nécessaires à la bifurcation écologique doit être prise en charge collectivement comme un défi majeur de notre temps.
L’État doit assumer son rôle de pilote en la matière, en lien avec la planification écologique (voir plan dédié à la règle verte), en organisant la définition des besoins de qualifications et des priorités de recherche finalisée, l’élaboration des contenus de formation, l’allocation des moyens.
Il doit le faire en s’appuyant sur un processus collectif qui mobilise toute la société, en associant les syndicats de salarié·es, les branches professionnelles, les chercheur·ses, les formateur·rices, les enseignant·es, les étudiant·es et les associations.
L’État doit pour cela pouvoir s’appuyer à nouveau sur des services publics nationaux de la formation et de la recherche qui assurent la cohérence et l’articulation entre formation initiale et formation continue d’une part, et recherche fondamentale, recherche finalisée et transfert des innovations d’autre part.
Comment qualifier et produire les savoirs utiles à la bifurcation écologique ?
Définir les besoins de qualification pour répondre à la bifurcation écologique
La jeunesse du pays est la clé de la bifurcation écologique à opérer. D’immenses chantiers attendent les Françaises et les Français : la gestion de l’eau, le passage à 100 % d’énergies renouvelables, la souveraineté alimentaire, l’agriculture écologique et paysanne, l’isolation de tous les logements, pour ne citer qu’eux.
Il faut mettre en mouvement toutes les forces vives pour y répondre. Si l’objectif est la bifurcation écologique face au changement climatique, cela doit se traduire dans les offres de formation initiale et tout au long de la carrière : il faut créer les nouvelles filières dont nous avons besoin, adapter les filières actuelles, réfléchir partout sur la façon dont chaque métier va être modifié par ce changement profond de mode de production et de consommation.
Le gouvernement de l’Union populaire s’attèle pour cela à reconstruire le service public de l’enseignement et de la formation professionnels. Il associe les organisations syndicales des salarié·es et fonctionnaires, du patronat, des lycéen·nes et des étudiant·es.
Rétablir le cadre national des diplômes
Notre gouvernement rétablit d’abord le cadre national des diplômes, c’est-à-dire un cadre national unique qui fixe les contenus d’enseignement correspondant à chaque diplôme. Ce contenu est identique entre la voie scolaire et l’apprentissage : il est sanctionné par un examen terminal. Il prévoit des enseignements généraux et disciplinaires renforcés, permettant une qualification durable. Ces diplômes correspondent à des grades qui offrent des garanties salariales à travers les grilles de classification des conventions collectives.
Nous créons un Conseil national de la qualification professionnelle qui a pour mission l’élaboration et la révision de ce cadre national des diplômes et des certifications pour répondre aux objectifs de qualification fixés par la loi de planification écologique (voir plan dédié à la règle verte).
Il est le lieu pour établir collectivement les besoins de qualification et mettre en place, de façon organisée et coopérative, les formations nécessaires pour y répondre. Il regroupe pour cela :
- les acteurs et actrices de la formation : Éducation nationale, universités, Greta, Centre national des arts et métiers (CNAM), Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), Centre national de l’enseignement à distance (CNED),
- les représentant·es des salarié·es : confédérations et unions syndicales interprofessionnelles,
- des acteurs et actrices économiques : Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), chambres de commerce et d’industrie (CCI), Chambres d’agriculture, syndicats d’exploitations agricoles,
- les organisations patronales et les branches professionnelles,
- les collectivités territoriales, en particulier les régions et communes,
- les syndicats enseignants, les associations de parents d’élèves, les représentant·es des étudiant·es et des lycéen·nes,
- des acteurs et actrices du monde associatif : associations d’usager·es, de consommateur·rices, ONG, associations environnementales…
Définir les besoins de formation en lien avec la bifurcation écologique
La première tâche du Conseil national de la qualification professionnelle est de quantifier le nombre de travailleurs et travailleuses, métier par métier, qui seront nécessaires dans les prochaines années.
Il s’appuie pour cela sur les objectifs sectoriels fixés, pour chaque domaine de la production, par la loi de planification écologique (voir plan dédié à la règle verte) et sur les plans de relocalisation que l’Agence pour la relocalisation aura établis sur cette base (voir plan dédié à la relocalisation).
Besoin de qualifications !
Pour sortir du nucléaire
Ainsi, si la loi de planification écologique a inscrit, comme nous le souhaitons, l’objectif de 100 % d’énergies renouvelables en 2050 et de sortie du nucléaire, le Conseil aura à quantifier les besoins de qualification qui en découlent : comment former 5 000 ouvrier·es spécialisé·es pour démanteler les centrales nucléaires ? Comment former les salarié·es du nucléaire et des énergies fossiles, aujourd’hui déjà hautement qualifié·es, pour assurer leur reconversion et leur contribution à ce défi décisif pour le pays ?
Pour développer l’économie de la mer
Sortir du nucléaire et passer à 100 % d’énergies renouvelables nécessitera un développement massif des énergies marines : éoliennes en mer, hydroliennes, énergie thermique de la mer, usines marémotrices… La France dispose de la deuxième zone économique exclusive du monde : nous initions un nouveau rapport à l’océan et à ses ressources, notamment halieutiques. Certains matériaux issus de la mer, telles les algues, constituent par exemple une partie de la solution pour sortir du plastique.
Le développement de l’économie de la mer nécessite une politique de qualification spécifique. C’est pourquoi nous créons un lycée professionnel des métiers de la mer dans chaque département maritime qui, à ce jour, n’en compte pas.
Pour passer à des transports écologiques
L’urgence climatique impose de décarboner massivement et rapidement le secteur des transports. Le secteur des transports, et notamment l’aéronautique, sera fortement impacté par une politique de réduction des gaz à effet de serre.
100 000 emplois doivent être créés en moins de six ans pour développer le secteur ferroviaire, et des milliers de salarié·es doivent être accompagné·es dans leur reconversion.
Secteur par secteur, le Conseil quantifie ainsi les besoins dans le temps. Il s’appuie pour cela sur les commissions professionnelles consultatives, qui réunissent en particulier les représentant·es des salarié·es, des branches professionnelles et des organisations agricoles. Elles organisent notamment des auditions de chercheur·ses, d’économistes et travaillent en lien permanent avec le Conseil de la planification écologique et l’Agence pour la relocalisation.
Adapter le contenu des formations aux métiers de demain
Des groupes de travail par métier interrogent le contenu des formations, les savoirs transposables de l’une à l’autre et la formation de formateurs et formatrices, comme l’ANPE l’avait fait en 1989 lors de la création du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois.
Ils associent pour cela des salarié·es, des formateurs et formatrices à ces métiers, des chercheurs et chercheuses dans le domaine, les branches professionnelles, des jeunes actuellement en formation et des représentant·es d’associations du domaine concerné. Leur travail s’appuie sur des auditions et des visites de sites : ils ont pour mission d’anticiper les évolutions technologiques à venir pour former des producteurs et productrices capables d’impulser et de s’adapter à ces bouleversements.
Ce travail permet d’établir concrètement le cadre national des diplômes : chaque diplôme correspond à l’obtention des qualifications nécessaires aux métiers non seulement d’aujourd’hui, mais également de demain et d’après-demain. Il est reconnu nationalement car son contenu est identique partout. Il ouvre droit aux mêmes garanties collectives.
Ce cadre est validé par un arrêté du gouvernement, après avis notamment du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et du Conseil supérieur de l’éducation (CSE).
Le répertoire national des certifications professionnelles est placé sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale et conservé au siège des Arts et Métiers.
Organiser la coopération entre acteurs publics pour qualifier tout le monde
Le cadre national des diplômes est la base de l’établissement de la carte nationale des formations. C’est la dernière tâche du Conseil : il s’appuie pour cela sur l’ensemble des acteur publics de la formation présents en son sein et sur les collectivités territoriales pour localiser les capacités d’accueil formation par formation. Cette répartition territoriale organise la complémentarité et la coopération entre les organismes de formation publics, plutôt que leur mise en concurrence. Elle guide le plan de rénovation et d’extension des locaux.
Un service public de l’enseignement et de la formation professionnels pour qualifier tout le monde
La restauration du cadre national des diplômes est le premier pilier du rétablissement d’un service public de la formation professionnelle initiale et continue qui réponde aux objectifs sociaux fixés collectivement plutôt qu’au court-termisme du marché.
Pour permettre à chacune et chacun d’accéder à la qualification et pour qualifier massivement, nous devrons aussi reconstruire l’outil, c’est-à-dire les filières publiques d’enseignement professionnel qui ont été dévastées. Il y a fort à faire.
Développer des centres polytechniques professionnels sur tout le territoire
Le gouvernement de l’Union populaire crée des centres polytechniques professionnels. Ces centres associent des formations publiques, du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au brevet de technicien supérieur (BTS) ou encore, lorsque cela est pertinent, des instituts universitaires technologiques (IUT) et licences professionnelles. Ils permettent la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Ces centres maillent le territoire national pour permettre l’accès du plus grand nombre et lutter contre les déserts de formation. Pour cela, ils s’appuient sur les structures existantes : les lycées professionnels et polyvalents, les groupements d’établissements (Greta), les centres de l’Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les instituts du Centre national des arts et métiers (CNAM), les instituts universitaires technologiques (IUT) ou les universités. Le ministère lance pour cela un plan massif d’investissement pour la rénovation et l’extension de leurs locaux et pour les équiper en matériels performants. Il recrute des formateurs et des formatrices.
Les centres polytechniques professionnels sont, avec les structures existantes dont les moyens sont renforcés, l’outil essentiel du service public de la formation professionnelle.
Vers une agriculture écologique et paysanne
Pour assurer la transition vers une agriculture écologique et paysanne, nous avons besoin de former au moins 300 000 agriculteurs et agricultrices supplémentaires, et d’accompagner les 400 000 actuel·les ainsi que les 250 000 ouvrier·es agricoles.
L’outil crucial pour cela sera le service public de l’enseignement agricole. Or, il forme actuellement moins de 70 000 agriculteurs et agricultrices par an. Le nombre d’agriculteur·rices est en baisse de 1 % à 3 % par an : au total, il a baissé de 34 % entre 1996 et 2017. La moitié des agriculteur·rices partira en retraite d’ici dix ans.
D’autre part, les contenus des formations et les outils de transfert sont trop souvent aux mains des lobbys : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Association nationale des industries alimentaires (ANIA) et grande distribution.
Nous augmentons donc le nombre de lycées agricoles publics, et nationalisons une partie des lycées privés, qui se sont multipliés jusqu’à être aujourd’hui quasiment aussi nombreux que les lycées publics. Les créations permettent de combattre les déserts de formation : de nombreux départements ruraux ne comptent qu’un seul lycée par département.
Nous abrogeons les dispositions de la loi Pénicaud qui ont libéralisé l’enseignement agricole et professionnel, et revenons à des offres et des contenus de formations décidés par l’État, les partenaires sociaux et les citoyen·nes avec comme objectif d’assurer une transition vers une agriculture écologique et d’acquérir un esprit critique, de synthèse et une vision globale qui donne aux travailleuses et aux travailleurs agricoles la capacité d’être les pilotes de cette révolution agricole.
Les missions et le fonctionnement des chambres d’agriculture et des instituts techniques sont profondément transformés. Ils ont, exclusivement, une mission de service public au service de la transition écologique de l’agriculture et de la production alimentaire. Afin d’en faire un outil efficace, leur gouvernance est revue et la représentation d’une diversité d’acteurs et d’actrices garantie : agriculteur·rices (système de représentation proportionnelle à tous les niveaux), salarié·es agricoles, propriétaires, collectivités territoriales, associations de défense de l’environnement et des consommateur·rices.
Rétablir un enseignement professionnel de haut niveau
Nous rétablissons le baccalauréat professionnel en quatre ans et les CAP en trois ans, comme jusqu’en 2011 et conformément à l’extension de l’instruction obligatoire à 18 ans.
À l’issue d’une concertation avec les organisations syndicales, les représentant·es des parents d’élèves et des lycéen·nes, le contenu des formations est revu pour prévoir davantage d’heures d’enseignements généraux, revenant sur les baisses des dernières années : à titre d’exemple, le français et l’histoire-géographie ne représentent aujourd’hui que 2,5 heures hebdomadaires, voire 1,5 seulement l’année du baccalauréat, contre 4,5 auparavant. Les cursus courts dans l’enseignement supérieur sont protégés et le « bachelor universitaire de technologie » transformé en véritable licence universitaire technologique.
L’apprentissage est réservé aux formations où cela est pertinent d’un point de vue pédagogique, et supprime progressivement les aides à l’embauche d’apprenti·es versées aux entreprises. Ces moyens seront intégralement destinés au financement des lycées professionnels et notamment des nouveaux centres polytechniques professionnels.
Sortir l’enseignement et la formation professionnels des mains du marché
La création des centres de formation d’apprentis (CFA) est à nouveau encadrée, sous l’autorité des régions. La délivrance de nouveaux diplômes privés professionnels qui n’entrent pas dans le cadre national est interdite. Les CFA d’entreprises prennent fin et les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont supprimés. Les « bachelors » des écoles, dont le contenu ne correspond pas à celui d’un diplôme prévu par le cadre national, n’obtiendront plus le grade de licence. Ainsi, le cadre national des diplômes devient effectif.
Nous supprimons l’obligation de mise en concurrence entre organismes de formation. Les formations sont confiées en priorité aux organismes de formation publics, comme l’AFPA, les Greta, les centres polytechniques professionnels ou encore les universités.
Garantir le droit à la formation pour toutes et tous
Nous garantissons le droit à la formation pour toutes et tous, quelle que soit son origine sociale, géographique, ses moyens financiers ou son expérience scolaire.
Ce droit passe d’abord par la généralisation de la gratuité réelle : gratuité réelle de l’enseignement professionnel (équipements, matériel et fournitures compris) et gratuité des formations professionnelles publiques pour les non-diplômé·es et les personnes sans emploi notamment.
Ce droit passe par une garantie d’autonomie versée à tous les jeunes dès 18 ans, et dès 16 ans dans l’enseignement professionnel, d’un montant de 1 063 euros par mois, dès lors qu’ils sont détachés du foyer fiscal de leur parent. Cette garantie d’autonomie permet aux jeunes de suivre leur scolarité sans devoir prendre un emploi à côté, une réalité qui aujourd’hui concerne particulièrement l’enseignement professionnel et qui est un des premiers facteurs d’échec ou d’abandon.
Il passe aussi par la création d’internats de proximité, dont certaines places sont réservées aux élèves de la voie professionnelle et aux apprenti·es sous statut scolaire, en donnant la priorité aux élèves les plus éloigné·es de leurs établissements ou lieux d’apprentissage.
Il passe enfin, pour les salarié·es, par la création d’une Sécurité sociale professionnelle qui garantit notamment la continuité du droit personnel à la formation tout au long de la vie, y compris hors du contrat de travail : ce droit est désormais lié à la personne, comme aujourd’hui la carte Vitale garantit la continuité du droit à la santé. Les travailleur·ses pourront ainsi choisir librement leur domaine de formation et élever leurs qualifications. Chaque salarié·e bénéficie par ailleurs d’un droit à 36 heures de formation par an, librement utilisables dans le domaine de son choix.
Le droit à la formation et à la reconversion des salarié·es dont les métiers sont amenés à évoluer du fait de la bifurcation écologique est garanti. Cela nécessite un effort financier de formation des salarié·es sans précédent, auquel l’État et les employeurs se doivent, chacun à leur niveau, de répondre.
Le gouvernement de l’Union populaire revient sur la politique de désengagement des employeurs dans le financement de la formation continue. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, votée sous la présidence de François Hollande, a supprimé une partie de l’obligation légale de financement de la formation continue. Le montant de l’obligation légale de financement de la formation continue est augmenté. Les employeurs devront également consacrer une part de l’augmentation des fonds mutualisés de la formation professionnelle continue à la reconversion des salarié·es dans les secteurs impactés par la bifurcation écologique. Cette part est fixée par décret et évolue en fonction des besoins.
Les choix concernant la formation des salarié·es dont les métiers sont amenés à évoluer du fait de la bifurcation écologique ne peuvent relever du simple bon vouloir du patronat. Les organisations syndicales de salarié·es au niveau national, sectoriel et territorial, ainsi que les associations engagées dans la bifurcation écologique, retrouvent un véritable pouvoir de décision sur les modalités de reconversion et de qualification nécessaires aux nouveaux besoins. La gestion des fonds paritaires de la formation professionnelle continue et la régulation du système de formation continue sont assurées par le Conseil national de la qualification professionnelle.
Favoriser la production et le transfert des connaissances finalisées
La capacité de production de savoirs finalisés est le deuxième enjeu décisif pour réussir la bifurcation écologique. La production de nouvelles techniques nécessite en effet une recherche finalisée de qualité.
Parce que les vraies révolutions sont souvent assez inattendues et procèdent d’avancées dans des recherches plus fondamentales, le développement de la recherche finalisée ne peut s’envisager sans renforcer également la recherche fondamentale, avec laquelle elle forme un continuum.
Parce que ces savoirs, pour contribuer à la bifurcation, doivent être partagés avec le plus grand nombre, la recherche doit rester constamment en lien avec la formation, notamment au sein de l’université.
Parce que la transformation radicale de nos modes de production devra affronter de très nombreux lobbys, comme dans l’énergie (nucléaire, pétrole), la construction (ciment, polystyrènes) ou l’agriculture (entreprises de semences et de pesticides), nous devons plus que jamais garantir l’indépendance des scientifiques travaillant sur ces domaines de recherche finalisée. C’est une condition essentielle pour que leurs travaux soient de qualité et reconnus par l’ensemble des citoyennes et des citoyens.
En même temps, le dialogue entre chercheur·ses indépendant·es et citoyen·nes est plus nécessaire que jamais pour promouvoir des changements radicaux, comme l’a montré la Convention citoyenne pour le climat.
Ainsi s’agit-il pour nous de redonner confiance et perspectives à la communauté scientifique, victime d’un véritable abandon, voire mépris, institutionnel depuis tant d’années. Cela passe d’abord par l’attribution de nouveaux moyens, en rupture nette avec l’austérité qui a fragilisé la recherche publique.
Le gouvernement de l’Union populaire s’attache à mener deux chantiers dans cette perspective : l’adaptation du service public de la recherche finalisée et du transfert face à la bifurcation écologique et la refondation du service public de la recherche scientifique.
Adapter le service public de la recherche finalisée et le transfert à la bifurcation écologique
Ce premier chantier mobilise :
- Les instituts de recherche finalisée impliqués dans la bifurcation écologique : l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
- Les acteurs opérationnels publics de la bifurcation écologique : Office national des forêts (ONF), Office français de la biodiversité (OFB), Agences de l’eau, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE), etc.
- Les acteurs privés : industrie agro-alimentaire, producteurs d’énergie.
- Les collectivités territoriales.
Des concertations sont lancées pour définir les évolutions à apporter aux missions et aux statuts de chaque institut.
Nous libérons la recherche publique en agronomie du poids des lobbys privés en garantissant un financement 100 % public des instituts, comme l’INRAE, le CIRAD, des universités ainsi que de toutes les institutions publiques de recherche du domaine agricole. Ces lobbys privés ne sont en conséquence plus représentés dans la gouvernance de ces institutions.
Les missions des différents instituts du domaine de l’énergie sont mises en cohérence avec la politique de la nation : elles participent toutes au développement des énergies renouvelables, à la sobriété énergétique et à la sortie du nucléaire. Une concertation spécifique avec les personnels des instituts concernés permet d’aboutir soit à la redéfinition des missions et des statuts de chaque institut, notamment le CEA, soit à la création d’un nouvel institut chargé de la bifurcation énergétique.
Refonder le service public de la recherche scientifique
Pour refonder le service public de la recherche scientifique, il s’agit d’abord de mettre en place les conditions essentielles de la confiance pour la communauté scientifique et pour toute la société.
Nous rehaussons le niveau d’investissement public dans la recherche en consacrant les 7,7 milliards actuellement dépensés dans un crédit d’impôt recherche (CIR) inefficace.
Nous lançons des plans généraux de thèmes de recherche sur des secteurs d’avenir : la mer, l’espace et le numérique sont aujourd’hui par exemple des mines de savoir, de développement, d’innovation et d’enthousiasme collectif.
Nous garantissons l’indépendance des enseignant·es-chercheur·ses et l’inscription de leur travail sur le temps long par un statut national unique et des financements pérennes. Pour cela, l’Agence nationale de la recherche (ANR) est supprimée.
Nous promouvons le caractère collectif de la recherche et de l’enseignement et sortons pour cela le service public de la logique de compétition généralisée entre établissements et laboratoires. À ce titre, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) et les primes au mérite sont supprimés. Un service public de la publication scientifique est créé, garantissant l’accès ouvert et gratuit aux publications universitaires et scientifiques, aujourd’hui largement privatisées par quelques grands éditeurs qui les facturent aux universités !
Nous garantissons des moyens humains et des conditions de travail pour la recherche, par l’embauche de 30 000 personnels statutaires dans les universités et la recherche, la titularisation des personnels précaires et la revalorisation des bas salaires, y compris pour les doctorant·es et les jeunes chercheur·ses.
Combien ça coûte, combien ça rapporte
Le premier volet de dépenses du plan est consacré à l’investissement massif dans le développement, l’extension et la rénovation des lycées professionnels, agricoles et maritimes, ainsi que la création des centres polytechniques professionnels. Un plan d’investissement de cinq milliards sur l’ensemble du mandat y sera consacré.
Les recrutements liés à l’ouverture des nouveaux établissements auront un coût de 500 millions d’euros par an en fin de mandat. Ce coût sera compensé par la suppression progressive des aides à l’embauche d’apprenti·es versées par l’État et les régions ainsi que la réforme de la taxe d’apprentissage qui est rééquilibrée en faveur des lycées professionnels publics.
La formation continue sera financée notamment par la hausse de l’obligation légale de financement par les entreprises.
Le second volet est consacré à l’augmentation de l’effort de recherche et développement du pays à 3 % du PIB en fin de mandat. La recherche publique sera ainsi dotée de neuf milliards d’euros supplémentaires, correspondant à une hausse de 10 % par an du budget des établissements publics de recherche et à 30 000 nouveaux personnels, toutes catégories confondues. Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente aujourd’hui 7,7 milliards d’euros.
Ces dépenses consacrées à la formation et à la recherche ont des impacts macroéconomiques positifs à moyen terme, à travers notamment la hausse de la productivité, ainsi que sur les finances publiques, à travers la réduction du nombre de sorties sans qualification du système scolaire, la diminution du taux de chômage et la création d’emplois durables.